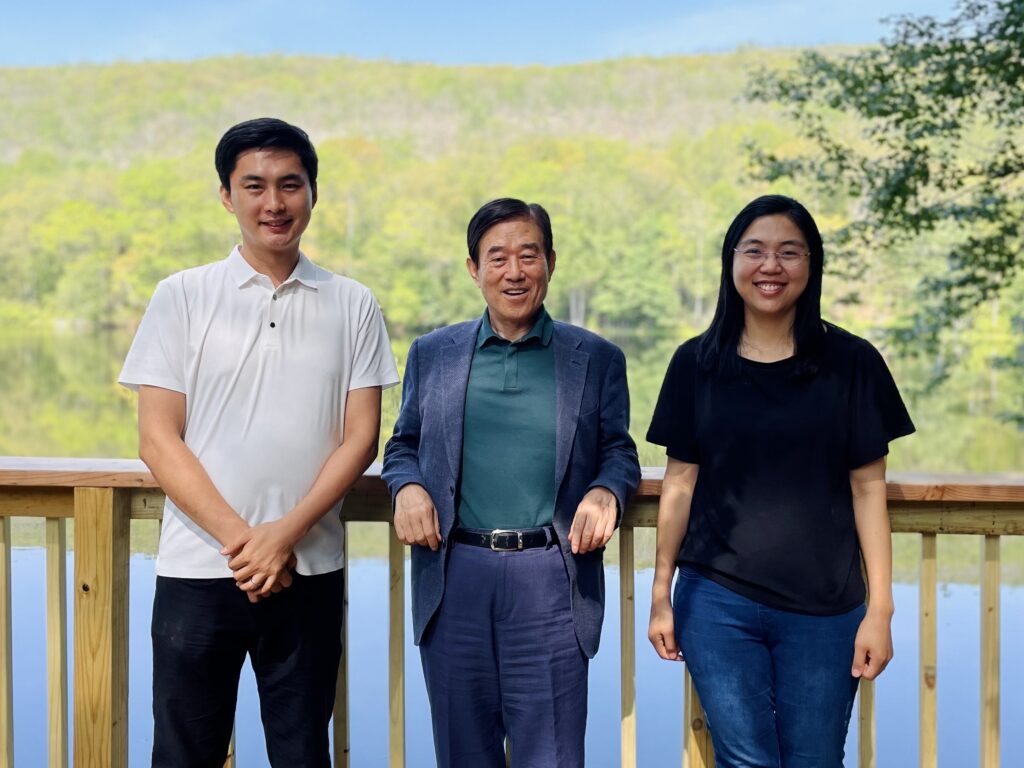1. Le ministère de Paul et l’appel de Timothée
Le pasteur David Jang a étudié avec l’assemblée la scène où Jésus ressuscité apparaît à ses disciples, pour mieux comprendre la mission que le Seigneur nous a confiée. Le chapitre 21 de l’Évangile selon Jean se divise en trois grands volets : le premier traite de la mission (l’œuvre missionnaire), le deuxième concerne le soin pastoral (l’œuvre pastorale) et le troisième se rapporte au temps de la fin (l’eschatologie). Selon ces trois thèmes, nous pouvons discerner l’exhortation profonde que le Seigneur a laissée à ses disciples : qu’il n’y ait pas de confusion, mais que chacun accomplisse pleinement la tâche qui lui est confiée. Même après sa résurrection, le Seigneur leur révèle de nouveau qui Il est et ce à quoi ils sont appelés. Le même principe s’applique encore aujourd’hui : en tant que croyants au Seigneur ressuscité, nous devons, en gardant à l’esprit l’évangélisation, le soin pastoral et l’espérance de la fin des temps, remplir clairement la mission qui nous est confiée et assumer nos responsabilités.
Après cette méditation sur Jean 21, l’Église a achevé l’étude des deux épîtres aux Thessaloniciens. Ces lettres contiennent un enseignement profond sur l’eschatologie, ainsi que des avertissements et des exhortations pastorales pratiques adressés à la belle Église de Thessalonique, et ces enseignements restent riches pour l’Église d’aujourd’hui. Ensuite, la suite logique nous mène aux épîtres pastorales de Paul (Première et Deuxième à Timothée, Tite), auxquelles le pasteur David Jang souhaite attirer notre attention. Ces épîtres pastorales sont des lettres où Paul, le mentor, donne des directives sur le ministère pastoral à ses disciples Timothée et Tite : elles abordent la gestion de l’Église, l’attitude pastorale, la manière de prendre soin des fidèles, l’ordre au sein de la communauté, etc. Ce sont donc des textes fondateurs pour comprendre le fonctionnement et l’organisation de l’Église.
Le pasteur David Jang a également expliqué comment la théologie pastorale s’est développée au fil de l’histoire de l’Église. Il y eut la Réforme protestante (Reformation) face à l’Église catholique romaine (l’ancienne Église), menée par Luther, Calvin (Calvin), Zwingli et d’autres grands réformateurs. De là est né le protestantisme orthodoxe (Protestant Orthodoxy), auquel s’est opposée la théologie libérale (liberalism). Devant l’ampleur de la désintégration qu’occasionnait la théologie libérale dans l’Église, un mouvement de retour à l’orthodoxie protestante a surgi, appelé « néo-orthodoxie » (Neo-Orthodoxy). Des théologiens comme Karl Barth (auteur de La Dogmatique ou Kirchliche Dogmatik), Paul Tillich, Emil Brunner et Reinhold Niebuhr se sont investis dans la défense de l’Évangile. Parmi eux, Karl Barth travaillait à Bâle (en Suisse).
Eduard Thurneysen (1888-1974), un théologien originaire de Bâle, en Suisse, a grandement influencé la pensée de son époque en élaborant la théologie pastorale. Il a étudié à l’université de Bâle, puis a ensuite enseigné à l’université de Berlin. Son ouvrage majeur, Le ministère pastoral (Die Lehre von der Seelsorge ou Die Pastorale selon les éditions), donne des indications concrètes sur la manière d’exercer le ministère pastoral dans la réalité quotidienne de l’Église. Le pasteur David Jang se souvient combien, dans sa jeunesse, il était passionné par les écrits de Thurneysen et combien il rêvait de visiter Bâle chaque fois qu’il se rendait en Europe.
La théologie pastorale fait partie de la théologie pratique (practical theology), l’une des grandes branches de la théologie. Classiquement, on étudie la théologie de la manière suivante : en première année, on acquiert les bases générales ; en deuxième année, on étudie la théologie biblique et l’histoire de l’Église (histoire ecclésiastique) ; en troisième année, on se consacre à la théologie systématique (systematic theology), c’est-à-dire la doctrine, et enfin, en quatrième année, on aborde la théologie pratique. Dans cette dernière, la prédication (homilétique) et la théologie pastorale (pastorale) occupent une place centrale. Or, la théologie pastorale puise ses racines dans l’Écriture. Parmi les textes bibliques, les épîtres pastorales de Paul (Première et Deuxième à Timothée, Tite) contiennent l’essentiel et la structure fondamentale du soin de l’Église. Ainsi, pour quiconque a la responsabilité de prendre soin de l’Église, ces lettres pastorales constituent un guide majeur.
Après les épîtres pastorales, on trouve l’épître à Philémon. Même si Paul la destine initialement à un individu (Philémon), elle renferme des exhortations précieuses à lire en communauté. Ainsi, après les treize épîtres de Paul (de l’épître aux Romains à celle de Philémon), se trouve l’Épître aux Hébreux, dont l’auteur n’est pas explicitement mentionné, ce qui a nourri de longs débats. Le style ne correspond pas à une épître classique de Paul (sa formule d’ouverture et de conclusion, ses salutations spécifiques ne s’y retrouvent pas). Toutefois, dans les dernières lignes d’Hébreux, on lit : « Sachez que notre frère Timothée a été relâché ; s’il vient bientôt, je vous verrai avec lui » (Hé 13.23). Certains spécialistes se fondent sur ce rapport étroit entre Paul et Timothée (souvent souligné par Paul) pour attribuer l’Épître aux Hébreux à Paul, mais la question reste ouverte.
Quoi qu’il en soit, Timothée, un collaborateur très proche de Paul, apparaît dans de nombreuses lettres pauliniennes. Parmi ceux à qui Paul confiait la charge pastorale effective dans son équipe (Timothée, Tite, et d’autres), Timothée et Tite se distinguent particulièrement. D’innombrables serviteurs anonymes ont aussi œuvré sans être cités. Rien qu’en Romains 16, Paul mentionne une multitude de collaborateurs. Il valorisait la « mission d’équipe » et menait avec eux la double mission d’évangélisation et de soin pastoral. Parmi ces collaborateurs, Timothée occupe une place de choix, au point d’être mentionné comme « co-auteur » dans six lettres (2 Corinthiens, Philippiens, Colossiens, 1 et 2 Thessaloniciens, Philémon).
Pour comprendre qui est Timothée, rappelons qu’il fut recruté par Paul lors de son deuxième voyage missionnaire, quand celui-ci repassa par Derbe et Lystres (Ac 16.1-3). Sa mère était une Juive croyante, son père un Grec, et sa grand-mère Loïs était également une femme de foi, nous apprend Paul dans la Deuxième épître à Timothée. Timothée était doux de caractère et, placé dans des situations difficiles (en proie aux persécutions de l’extérieur comme aux faux docteurs dans l’Église), il était de nature inquiète, au point de souffrir de maux d’estomac (1 Tm 5.23). Dans la Deuxième à Timothée (1.4), Paul rappelle aussi qu’il était un homme qui pleurait facilement.
Lors du premier voyage missionnaire, Paul était parti d’Antioche avec Barnabas et Marc pour proclamer l’Évangile dans plusieurs régions. À Lystres, il guérit un homme impotent de naissance, ce qui suscita un vif émoi parmi la population, qui voulut diviniser Paul et Barnabas. Mais Paul rejeta fermement cet excès et poursuivit la proclamation de l’Évangile. Les Juifs, jaloux, allèrent jusqu’à lapider Paul à Lystres et le laissèrent comme mort hors de la ville. Cependant, Dieu le releva (Ac 14.19-20). Fait intéressant, « Lystres » signifie « troupeau de brebis », pourtant, ce fut là que Paul faillit mourir. Il y connut souffrances et larmes, puis une résurrection miraculeuse. Or, au cours du deuxième voyage missionnaire, quand Paul revient dans cette région, il rencontre Timothée (dont le nom signifie « honorer Dieu ») et l’emmène comme collaborateur. À Lystres, un lieu chargé de sang et de larmes pour Paul, Dieu avait préparé pour lui Timothée, un précieux compagnon de ministère.
La Première épître à Timothée est généralement datée des années 63-65 apr. J.-C. : Paul, après avoir été assigné à résidence à Rome pendant deux ans, aurait été libéré et aurait repris la route missionnaire. Au cours de ce périple, il laissa Tite en Crète (Tt 1.5) et Timothée à Éphèse. L’Église d’Éphèse était l’une des plus importantes, où Paul avait servi trois années entières (Ac 20.31), et qui avait connu une grande croissance. Paul rêvait de se rendre jusqu’en Hispanie (l’actuelle Espagne) pour y prêcher l’Évangile (Rm 15.28), toujours prompt à franchir de nouvelles frontières. Pourtant, il devait maintenir un lien avec l’Église d’Éphèse, en proie aux faux docteurs. Il chargea donc Timothée de rester sur place pour faire face à ces perturbateurs et consolider l’Église.
Le pasteur David Jang a lu et commenté la Première à Timothée, mettant en lumière le sens et le contexte de la lettre. Dès l’introduction, Paul salue ainsi :
« Paul, apôtre de Jésus-Christ par ordre de Dieu notre Sauveur et de Jésus-Christ notre espérance » (1 Tm 1.1).
Le terme « Sauveur » (sôtêr, σωτήρ en grec) était habituellement réservé à l’empereur romain. En l’appliquant à Dieu, Paul souligne que le véritable Sauveur n’est pas l’empereur, mais Dieu seul. De même, le Christ Jésus est « l’espérance » de Paul et Timothée.
« À Timothée, mon enfant légitime dans la foi : Que la grâce, la miséricorde et la paix te soient données de la part de Dieu le Père et de Jésus-Christ notre Seigneur ! » (1 Tm 1.2).
Paul appelle Timothée « mon enfant légitime dans la foi », montrant ainsi le lien unique qui les unit. Dans la salutation, on trouve la formule « grâce, miséricorde et paix ». Habituellement, Paul utilise souvent « grâce et paix », mais l’ajout du terme « miséricorde » (ou « compassion ») est caractéristique de la Première et de la Deuxième à Timothée, où Paul médite profondément la miséricorde divine dont il a bénéficié.
Paul précise la raison pour laquelle il a laissé Timothée à Éphèse : « afin d’exhorter certaines personnes à ne pas enseigner d’autres doctrines » (1 Tm 1.3). À l’époque, de faux docteurs, s’appuyant sur des traditions juives ou des spéculations (mythes, généalogies interminables), déformaient l’Évangile accompli en Jésus-Christ. Par ailleurs, l’influence du gnosticisme semait la confusion et la discorde au sein de l’Église.
Le ministre pastoral doit protéger l’Église des « enseignements étrangers ». Aujourd’hui encore, des idéologies extérieures (sécularisme, etc.) s’infiltrent dans l’Église et menacent de dénaturer l’Évangile. C’est pourquoi le pasteur, en tant que gardien de l’Église, doit maintenir fermement la vérité et enseigner l’essentiel avec clarté. Telle est l’une des missions fondamentales du berger.
Paul souligne à quel point ceux qui se perdent en débats stériles, mythes et généalogies interminables se fourvoient (1 Tm 1.6-7). Il rappelle que la Loi est bonne (1 Tm 1.8), mais qu’elle a pour but de révéler le péché (1 Tm 1.9-11) et de conduire au Christ, seul capable de sauver. La Loi ne donne pas le salut, elle sert seulement de « pédagogue » (Ga 3.24) pour conduire les hommes à la grâce.
Paul qualifie l’Évangile de « l’Évangile de la gloire du Dieu bienheureux » (1 Tm 1.11) et exprime son immense reconnaissance d’avoir reçu cette bonne nouvelle, lui qui était si indigne :
« Je rends grâces à celui qui m’a fortifié, à Jésus-Christ notre Seigneur, de ce qu’il m’a jugé fidèle, en m’établissant dans le ministère » (1 Tm 1.12).
Le pasteur David Jang met particulièrement en valeur ce passage. Paul remercie le Seigneur qui l’a appelé et établi au ministère pastoral. Autrefois, Paul n’était pas seulement un incroyant, mais un persécuteur et un blasphémateur (1 Tm 1.13). Cependant, il a obtenu miséricorde, et il se décrit comme « le premier des pécheurs » (1 Tm 1.15). Cette confession sincère touche profondément aussi bien les pasteurs que les fidèles.
Selon le pasteur David Jang, « Le point de départ de tout ministère est la prise de conscience que nous sommes tous des pécheurs ». Un pasteur ignorant sa propre condition de pécheur pardonné ne peut pas servir l’Église avec amour. Comme l’exprime l’idée du « guérisseur blessé » (wounded healer), ce n’est que lorsqu’on a personnellement expérimenté le pardon et les larmes de la repentance que l’on peut porter et soigner les fautes et les blessures des autres.
« Mais j’ai obtenu miséricorde, afin qu’en moi le premier, Jésus-Christ manifestât toute sa patience, pour servir d’exemple à ceux qui croiraient en lui pour la vie éternelle » (1 Tm 1.16).
Paul déclare que, s’il a obtenu miséricorde bien qu’il fût « le premier des pécheurs », c’était pour devenir un modèle : si Christ a pu sauver le pire de tous, il peut sauver tout le monde. La grâce se révèle ainsi d’une puissance extraordinaire.
Le pasteur David Jang souligne encore l’importance de mener « le bon combat de la foi » (1 Tm 1.18) dans la réalité concrète du ministère. Il s’agit de s’opposer à de faux docteurs, de préserver l’essence de l’Évangile, d’aimer et de prendre soin des fidèles, de travailler en équipe et de partager joies et peines. Pourtant, il faudra parfois affronter la tristesse de voir certains faire naufrage dans la foi (1 Tm 1.19-20). Tel est le dur et beau paysage du service pastoral.
Paul termine le premier chapitre en rendant gloire « au Roi des siècles, immortel, invisible, seul Dieu » (1 Tm 1.17). Selon le pasteur David Jang, c’est là le but ultime de tout ministère et de toute vie de foi : rendre gloire à Dieu. Cette gloire n’est pas liée à nos mérites, mais au résultat de la compassion et de la grâce divines.
2. Un ministère édifié par la miséricorde
À ce stade, le pasteur David Jang souligne le thème central de la Première à Timothée, qui est le « ministère » soutenu par la « miséricorde ». Dans le chapitre 1, Paul dresse d’abord le constat des menaces qui pèsent sur l’Église (les faux docteurs, etc.), puis il conclut que la force motrice du ministère pastoral vient avant tout de la compassion (miséricorde) de Dieu. Souvenant qu’il était le « premier des pécheurs », Paul insiste sur la nécessité pour le pasteur de se rappeler sans cesse la miséricorde qu’il a lui-même reçue, afin de prendre soin de la communauté avec humilité.
Selon le pasteur David Jang, c’est précisément cette miséricorde qui rend possible l’amour. Dans 1 Tm 1.5, Paul écrit : « Le but de cette recommandation, c’est un amour venant d’un cœur pur, d’une bonne conscience, et d’une foi sincère. » Toute mise en garde et tout enseignement dans l’Église doivent avoir pour finalité « l’amour ». Or, cet amour jaillit naturellement dès lors que l’on prend la pleine mesure de la miséricorde infinie reçue du Seigneur. C’est là l’essence même du pastorat.
Le pasteur doit donc veiller attentivement aux événements tant à l’intérieur qu’à l’extérieur de l’Église : les influences séculières qui menacent la pureté du message, les faux docteurs, les querelles inutiles, mais aussi la souffrance silencieuse des membres qui servent avec dévouement. Pour gérer tout cela, il faut de l’humilité et des larmes. Comme Paul le témoigne en Actes 20.17-19, lorsqu’il fait ses adieux aux anciens d’Éphèse, il rappelle avoir servi « en toute humilité et avec beaucoup de larmes ». De la même manière, le pasteur David Jang ne cesse de répéter : « Le soin pastoral est une œuvre de larmes. » Timothée, certes timide, enclin aux pleurs, voire à un estomac fragile, n’en est pas moins la personne choisie pour conduire l’Église, car Dieu se plaît à utiliser ce qui est faible pour confondre les forts (1 Co 1.27).
Le pasteur David Jang souligne aussi la nécessité d’un ministère d’équipe. Paul comptait une multitude de collaborateurs, dont Timothée, Tite, Silas, Luc, Aquilas et Priscille, Épaphras, etc. L’Église ne saurait être le terrain de jeu d’un seul individu ; c’est la communauté qui porte la force de la mission, en partageant à la fois peines et joies.
De même, on ne peut séparer l’évangélisation (la mission) du soin pastoral. Lorsque le Seigneur ressuscité a confié sa mission aux disciples, Il leur a dit : « Vous serez mes témoins jusqu’aux extrémités de la terre » (Ac 1.8) et aussi « Pais mes agneaux » (Jn 21.15). Paul, dans ses voyages missionnaires, visitait à nouveau les Églises qu’il avait fondées, y laissait des responsables, ou leur écrivait pour les accompagner. L’Évangile suscite de nouveaux croyants, et il faut prendre soin de ces âmes. Ce soin pastoral est l’essence même du pastorat.
Or, le soin pastoral consiste avant tout à aimer. Sans amour, le soin pastoral ne peut s’exercer. Selon 1 Tm 1.5, cet amour provient d’un cœur pur, d’une bonne conscience et d’une foi sincère. Mais il s’agit aussi d’un amour qui n’est pas simplement le fruit de nos efforts, mais qui découle de la miséricorde de Dieu envers des pécheurs. Pour cette raison, Paul se qualifie de « premier des pécheurs » et se rappelle ce qu’il était auparavant. Ayant expérimenté un salut immense et l’amour de Dieu, Paul pouvait prêcher l’Évangile avec une ardeur incomparable, tout en craignant toujours que l’Église ne se disperse ou ne s’effondre, d’où ses nombreuses larmes pour son ministère.
C’est donc pour cela que les épîtres à Timothée et à Tite (dénommées « épîtres pastorales ») occupent une place à part parmi les lettres de Paul : elles détaillent ses principes pastoraux et sa vision de l’Église. En les parcourant, nous découvrons des indications concrètes sur les qualités requises pour l’encadrement de l’Église, l’attitude à adopter envers les fidèles, la prière et le culte, la gestion des faux enseignements et l’établissement de l’ordre ecclésial. Aujourd’hui encore, elles servent de socle théologique et pratique pour tout pasteur, dont le pasteur David Jang, dans l’accomplissement de son ministère.
Le pasteur David Jang relie ces considérations à 1 Tm 1, relevant notamment que les larmes de Timothée, mentionnées aussi en 2 Tm 1.4 (« me rappelant tes larmes »), ne sont pas un signe de faiblesse, mais bien l’expression d’un authentique dévouement pour protéger le troupeau. Paul, jusqu’au bout, a encouragé Timothée à ne pas baisser les bras, s’appuyant sur le souvenir de la miséricorde que Dieu avait d’abord manifestée à Paul lui-même.
La source la plus fondamentale du ministère, c’est la grâce et la miséricorde divines. Celui qui a reçu cette grâce et cette miséricorde se sent rempli de gratitude envers Dieu et, de ce fait, prend soin de l’Église. Ainsi, Paul affirme : « Je suis reconnaissant qu’il m’ait jugé fidèle et m’ait établi dans le service » (1 Tm 1.12). Le ministère n’est pas une fonction que l’on obtient par ses propres mérites ou ses résultats, mais un appel à servir au sein de l’Église, qui doit être perçu comme un honneur et un sujet d’action de grâce. Paul, persécuteur de l’Église, a reçu cette miséricorde en Christ. Chaque jour, il en était profondément reconnaissant, et c’est cette gratitude qui alimentait toute sa vie de service.
De même, si certains, comme Hyménée et Alexandre, persistent à nuire à l’Église et à rejeter la foi (1 Tm 1.19-20), le pasteur doit prendre les mesures nécessaires. Paul dit : « Je les ai livrés à Satan, afin qu’ils apprennent à ne plus blasphémer. » On comprend qu’il y a eu certainement une tentative de les ramener, mais que leur comportement destructeur envers l’Église a fini par exiger l’exclusion. Une telle fermeté est parfois indispensable pour préserver la sainteté de la communauté.
Il apparaît clairement que le ministère pastoral n’est pas un chemin aisé. Le pasteur David Jang le répète souvent dans ses sermons et conférences : « Le pastorat est à la fois une œuvre sacrée, car on prend soin du corps du Seigneur, et une entreprise impossible sans larmes. » Dans le duo formé par Paul et Timothée (ou par Paul et Tite), on entrevoit la réalité du pastorat. Un enseignement dénué d’amour mène au conflit et à la division. Mais celui qui s’enracine dans l’amour, issu de la grâce et de la miséricorde divines, va ranimer les âmes et édifier la communauté.
De nos jours, l’Église affronte de nombreux défis : sécularisation, pluralisme, matérialisme, humanisme menacent de diluer la vérité de l’Évangile. À l’intérieur même, on voit des erreurs théologiques, des manipulations égoïstes, des divisions entre fidèles, et la difficulté de se relever d’une crise comme celle de la Covid. Plus que jamais, nous devons puiser dans la sagesse que Paul adresse à Timothée. Au final, tout se ramène à l’amour, fruit de la grâce et de la miséricorde de Dieu, et à la persévérance dans « le bon combat de la foi » (1 Tm 1.18).
Le Seigneur ressuscité, en Jean 21, ordonne : « Pais mes brebis », et, en Actes 1.8, Il envoie ses disciples « jusqu’aux extrémités de la terre » pour être ses témoins. Cette double mission – évangélisation et soin pastoral – est inséparable. Paul, avec ses collaborateurs, a uni ces deux dimensions, au prix de bien des larmes et d’innombrables sacrifices. Ceux qui ont la charge de l’Église doivent se souvenir de la miséricorde dont ils ont eux-mêmes bénéficié, aimer les brebis et poursuivre l’annonce de l’Évangile jusqu’aux confins de la terre.
Le pasteur David Jang, dans son enseignement pour l’Église tant en Corée que dans le monde, ne cesse de souligner ce double enjeu (mission et pastorat) et d’inviter à adopter une attitude pleinement enracinée dans l’Écriture. En lisant la Première à Timothée, nous devons rendre gloire au Dieu qui nous sauve et remercier pour sa miséricorde envers nous, pécheurs. Cette reconnaissance doit nous pousser à dépasser les vaines discussions, à apaiser les troubles dans l’Église et à faire grandir un amour qui donne la vie.
Le chapitre 1 de la Première à Timothée s’achève sur l’appel de Paul à Timothée : « Défends l’Église et argumente pour l’Évangile, mais n’oublie jamais que toi aussi tu étais le premier des pécheurs et que tu as reçu la miséricorde. » Il n’y a point de place pour les mythes, les généalogies ou les controverses inutiles : le cœur du ministère de Paul se nourrit de la grâce et de la miséricorde du Seigneur. Aujourd’hui encore, responsables et fidèles doivent sans cesse revenir à cette base, pour que l’Église ne se transforme pas en arène de débats vains, mais demeure un lieu où règnent l’amour et la grâce.
Ce n’est certes pas un combat facile, comme l’a montré la situation de l’Église d’Éphèse, en proie à de puissantes secousses. Pourtant, de la même manière que Paul a pu se relever à Lystres, et que Timothée, fragile, a pu tenir bon, quiconque s’appuie sur l’amour et la compassion de Dieu reçoit la force nécessaire. Forts de cette force, nous pourrons édifier l’Église, servir Dieu notre Sauveur et le Christ notre espérance, et porter l’Évangile jusqu’aux extrémités de la terre. Voilà l’esprit que le pasteur David Jang n’a de cesse de prôner : un ministère et une mission fermement arrimés à la perspective eschatologique, avec les yeux fixés sur le retour du Seigneur.
Ainsi, l’enseignement de Jean 21 et l’exhortation de Paul à Timothée se rejoignent dans le même courant. Le commandement du Seigneur ressuscité et le témoignage pastoral de Paul convergent pour poser la base de la théologie pastorale. L’Église doit aimer son troupeau, repousser les faux enseignements, et se préparer au retour du Seigneur. Dans tout cela, comme le répète le pasteur David Jang, nous devons puiser à la « miséricorde de Dieu ». Nous étions des pécheurs, mais nous avons été sauvés, et c’est là le moteur impérissable qui alimente l’évangélisation et le ministère pastoral.